L'"arbre ardent" des enfants du KT





 La paroisse de Kayenta s’étend sur plus de 26.000 kilomètres carrés, c’est plus de deux fois la superficie de la région Ile-de-France ! Un territoire à cheval sur l’Arizona, l’Utah et le Nevada ; une telle étendue qu’on y change même de fuseau horaire… de quoi perdre un peu le visiteur de passage qui veut se rendre à la messe de Pâques…
La paroisse de Kayenta s’étend sur plus de 26.000 kilomètres carrés, c’est plus de deux fois la superficie de la région Ile-de-France ! Un territoire à cheval sur l’Arizona, l’Utah et le Nevada ; une telle étendue qu’on y change même de fuseau horaire… de quoi perdre un peu le visiteur de passage qui veut se rendre à la messe de Pâques…
 Le frère Jerry Herff, ancien supérieur des Lazaristes de Los Angeles, (ou «congrégation de la mission» fondée par saint Vincent de Paul), réside auprès des Indiens navajos à Kayenta sa terre de mission depuis neuf ans.
Depuis lors, il a célébré quatre mariages : c’est peu, pire encore lorsque l’on sait qu’un seul de ces couples était navajo. En six ans, le père Jerry n’a baptisé que deux enfants… mais célébré vingt-et-un enterrements ! Ce chiffre relativement élevé s'explique selon lui par un attrait certain des Navajos pour le rite funèbre mêlant fumée d’encens et eau bénite…
La première religion pratiquée sur ces terres reste le culte traditionnel chamanique navajo. La foi catholique vient ensuite, fruit d’une longue histoire missionnaire, puis la kyrielle d’églises protestantes caractéristique de ces villes de l’ouest.
Le frère Jerry Herff, ancien supérieur des Lazaristes de Los Angeles, (ou «congrégation de la mission» fondée par saint Vincent de Paul), réside auprès des Indiens navajos à Kayenta sa terre de mission depuis neuf ans.
Depuis lors, il a célébré quatre mariages : c’est peu, pire encore lorsque l’on sait qu’un seul de ces couples était navajo. En six ans, le père Jerry n’a baptisé que deux enfants… mais célébré vingt-et-un enterrements ! Ce chiffre relativement élevé s'explique selon lui par un attrait certain des Navajos pour le rite funèbre mêlant fumée d’encens et eau bénite…
La première religion pratiquée sur ces terres reste le culte traditionnel chamanique navajo. La foi catholique vient ensuite, fruit d’une longue histoire missionnaire, puis la kyrielle d’églises protestantes caractéristique de ces villes de l’ouest.
 mplement économiques. Mais ces difficultés semblaient décupler l’énergie et la foi de ces petites communautés. Nous ne pensions pas, en venant aux États-unis, trouver une telle misère spirituelle ni croiser la détresse d’un curé à la paroisse pourtant démesurée.
mplement économiques. Mais ces difficultés semblaient décupler l’énergie et la foi de ces petites communautés. Nous ne pensions pas, en venant aux États-unis, trouver une telle misère spirituelle ni croiser la détresse d’un curé à la paroisse pourtant démesurée. Avant d’entrer au séminaire, Luc était déjà un paroissien actif, engagé dans le catéchuménat et toujours volontaire pour s’occuper de la logistique, porter les cartons et accueillir les paroissiens qui suivaient avec lui la catéchèse des adultes, tous les quinze jours. Il connaît donc bien la vie paroissiale et en vit même au point de se revendiquer avec force comme "paroissien lambda", un baptisé parmi les baptisés, en chemin vers la sainteté. Qu’est-ce qui a changé alors ? Le regard qu’il pose sur son implication. "Je suis davantage "dans" et à la fois "en dehors" de la paroisse. Davantage en elle, car suivre le Christ c’est se donner concrètement, toujours plus. Davantage hors d’elle, car cette suite est aussi un chemin intérieur du Totus Tuus (tout à Toi) vers le "tout à tous". Ce chemin invite à se détacher de son propre désir dans la rencontre avec l’autre, afin de tendre vers Dieu pour servir gratuitement, à l’imitation du Christ. Je mesure combien, pendant ces deux ans, j’ai été aimé gratuitement par Dieu ; un amour qui passe par les actes gratuits des paroissiens, les sourires, les mots, les petits et même les grands gestes… Cette gratuité de l’amour des paroissiens m’invite à me donner moi-même. La paroisse, c’est le quotidien de ma vie parce qu’elle est le lieu de l’Eucharistie". Luc aime en particulier la messe dominicale de 11 h, où se dévoile, à travers les membres rassemblés du Corps du Christ, la vérité du mystère de l’Église.
Comme beaucoup d’entre nous, Luc est donc un paroissien heureux ! Comme nous, donc ? Pas tout à fait, pourtant. Nous voyons déjà en lui le futur prêtre, nous projetons en lui l’avenir de l’Église : voilà la relève ! Notre espérance s’incarne dans ce "paroissien lambda" que nous imaginons déjà ordonné… Or cet élan peut être une épreuve pour celui qui en est l’objet. Que devient, face à cette anticipation, la liberté du séminariste ? Luc accueille ce regard comme un appel à poursuivre le don de lui-même sous le regard le plus déterminant : celui du Christ.
Luc quittera l’an prochain Saint-Denys pour gagner une autre Maison de Séminaire : comment accepter ces continuels départs ? "Le départ est significatif de l’appel : un appel à se détacher de l’homme ancien pour "s’attacher" au Christ. Suivre le Christ, c’est l’essentiel de la mission. Un chrétien qui suit le Christ ne peut pas faire autre chose qu’ouvrir son cœur au cœur de son prochain, au cœur de celui qui est aimé de Dieu et qui ne le sait pas. Plus je connais Dieu, plus je le découvre comme source de bonheur et plus je veux le partager."
Avant d’entrer au séminaire, Luc était déjà un paroissien actif, engagé dans le catéchuménat et toujours volontaire pour s’occuper de la logistique, porter les cartons et accueillir les paroissiens qui suivaient avec lui la catéchèse des adultes, tous les quinze jours. Il connaît donc bien la vie paroissiale et en vit même au point de se revendiquer avec force comme "paroissien lambda", un baptisé parmi les baptisés, en chemin vers la sainteté. Qu’est-ce qui a changé alors ? Le regard qu’il pose sur son implication. "Je suis davantage "dans" et à la fois "en dehors" de la paroisse. Davantage en elle, car suivre le Christ c’est se donner concrètement, toujours plus. Davantage hors d’elle, car cette suite est aussi un chemin intérieur du Totus Tuus (tout à Toi) vers le "tout à tous". Ce chemin invite à se détacher de son propre désir dans la rencontre avec l’autre, afin de tendre vers Dieu pour servir gratuitement, à l’imitation du Christ. Je mesure combien, pendant ces deux ans, j’ai été aimé gratuitement par Dieu ; un amour qui passe par les actes gratuits des paroissiens, les sourires, les mots, les petits et même les grands gestes… Cette gratuité de l’amour des paroissiens m’invite à me donner moi-même. La paroisse, c’est le quotidien de ma vie parce qu’elle est le lieu de l’Eucharistie". Luc aime en particulier la messe dominicale de 11 h, où se dévoile, à travers les membres rassemblés du Corps du Christ, la vérité du mystère de l’Église.
Comme beaucoup d’entre nous, Luc est donc un paroissien heureux ! Comme nous, donc ? Pas tout à fait, pourtant. Nous voyons déjà en lui le futur prêtre, nous projetons en lui l’avenir de l’Église : voilà la relève ! Notre espérance s’incarne dans ce "paroissien lambda" que nous imaginons déjà ordonné… Or cet élan peut être une épreuve pour celui qui en est l’objet. Que devient, face à cette anticipation, la liberté du séminariste ? Luc accueille ce regard comme un appel à poursuivre le don de lui-même sous le regard le plus déterminant : celui du Christ.
Luc quittera l’an prochain Saint-Denys pour gagner une autre Maison de Séminaire : comment accepter ces continuels départs ? "Le départ est significatif de l’appel : un appel à se détacher de l’homme ancien pour "s’attacher" au Christ. Suivre le Christ, c’est l’essentiel de la mission. Un chrétien qui suit le Christ ne peut pas faire autre chose qu’ouvrir son cœur au cœur de son prochain, au cœur de celui qui est aimé de Dieu et qui ne le sait pas. Plus je connais Dieu, plus je le découvre comme source de bonheur et plus je veux le partager." nauté séminaristes ne manque pas, semble-t-il, de toucher les paroissiens de Saint-Denys. Pourtant, la paroisse est peut-être ce qui a pris pour moi les apparences du plus grand invariant dans ma nouvelle vie. Ancien paroissien et animateur d’aumônerie à Sainte-Elisabeth, qui jouxte le territoire de Saint-Denys, j’ai retrouvé ici un quartier et un engagement paroissial somme toute assez proches, puisque j’ai hérité des servants d’autels puis d’une équipe KT de CE2. En terme de temps, la paroisse ne me prend pas davantage qu’autrefois, la majeure partie de mon énergie de séminariste étant employée dans les études et la vie communautaire.
Comme beaucoup de paroissiens, c’est donc essentiellement à l’occasion de la messe dominicale mais aussi des « pots » qui lui succèdent fréquemment que j’ai pu vous rencontrer, et c’est surtout avec ceux qui ont une activité en commun avec moi ou ont des enfants catéchisés ou servants d’autel, que j’ai pu nouer des relations d’amitié. Autant de rencontres fraternelles qui sont un véritable bonheur et m’ont permis de me sentir encore l’un de vous, paroissien presque ordinaire, et de prendre quelques bains de « vraie » vie, hors du petit monde séminaristico-clérical.
Pour autant, une somme de petits décalages témoignaient de la mue progressive de ma vie, y compris comme paroissien. Spatialement d’abord. Logeant au presbytère, j’ai eu la joie de croiser fréquemment quelques paroissiens peu ordinaires, qui s’activent au chevet de l’église : Marie-Hélène au jardin, Jacques à la liturgie, Denise aux fleurs et à la bibliothèque…. Surtout, contrairement à beaucoup d’entre vous, je n’entre presque jamais dans l’église par la façade mais toujours par la sacristie, et reste dans le chœur, en aube, le dimanche à la messe. Temporellement ensuite, la pratique religieuse des séminaristes est parfois un peu décalée par rapport à celle de la plupart des paroissiens ; nous chantons par exemple les laudes et les vêpres presque chaque jour dans l’église, mais à des horaires peu chrétiens pour qui ne vit pas sur place ! A plus long terme, je sais de façon certaine que, contrairement à vous, il me faudra bientôt quitter pour toujours cette paroisse après deux ans passés ici. Et c’est ce détachement qui est finalement le plus difficile, signe concret du don de ma vie. Car pour le reste, le climat paroissial est tellement chaleureux et familial à Saint-Denys qu’il est à la limite de la publicité mensongère en faveur des vocations sacerdotales !
Paul
nauté séminaristes ne manque pas, semble-t-il, de toucher les paroissiens de Saint-Denys. Pourtant, la paroisse est peut-être ce qui a pris pour moi les apparences du plus grand invariant dans ma nouvelle vie. Ancien paroissien et animateur d’aumônerie à Sainte-Elisabeth, qui jouxte le territoire de Saint-Denys, j’ai retrouvé ici un quartier et un engagement paroissial somme toute assez proches, puisque j’ai hérité des servants d’autels puis d’une équipe KT de CE2. En terme de temps, la paroisse ne me prend pas davantage qu’autrefois, la majeure partie de mon énergie de séminariste étant employée dans les études et la vie communautaire.
Comme beaucoup de paroissiens, c’est donc essentiellement à l’occasion de la messe dominicale mais aussi des « pots » qui lui succèdent fréquemment que j’ai pu vous rencontrer, et c’est surtout avec ceux qui ont une activité en commun avec moi ou ont des enfants catéchisés ou servants d’autel, que j’ai pu nouer des relations d’amitié. Autant de rencontres fraternelles qui sont un véritable bonheur et m’ont permis de me sentir encore l’un de vous, paroissien presque ordinaire, et de prendre quelques bains de « vraie » vie, hors du petit monde séminaristico-clérical.
Pour autant, une somme de petits décalages témoignaient de la mue progressive de ma vie, y compris comme paroissien. Spatialement d’abord. Logeant au presbytère, j’ai eu la joie de croiser fréquemment quelques paroissiens peu ordinaires, qui s’activent au chevet de l’église : Marie-Hélène au jardin, Jacques à la liturgie, Denise aux fleurs et à la bibliothèque…. Surtout, contrairement à beaucoup d’entre vous, je n’entre presque jamais dans l’église par la façade mais toujours par la sacristie, et reste dans le chœur, en aube, le dimanche à la messe. Temporellement ensuite, la pratique religieuse des séminaristes est parfois un peu décalée par rapport à celle de la plupart des paroissiens ; nous chantons par exemple les laudes et les vêpres presque chaque jour dans l’église, mais à des horaires peu chrétiens pour qui ne vit pas sur place ! A plus long terme, je sais de façon certaine que, contrairement à vous, il me faudra bientôt quitter pour toujours cette paroisse après deux ans passés ici. Et c’est ce détachement qui est finalement le plus difficile, signe concret du don de ma vie. Car pour le reste, le climat paroissial est tellement chaleureux et familial à Saint-Denys qu’il est à la limite de la publicité mensongère en faveur des vocations sacerdotales !
Paul
 condamne pas l’amour mais l’absence d’amour ! Enfin vient le week-end de clôture, où se retrouvent les couples qui désormais se connaissent bien. Le samedi soir, c’est la fête autour d’un dîner suivi d'un petit "topo" du père Quinson autour de la question difficile "Qui est Dieu?"
condamne pas l’amour mais l’absence d’amour ! Enfin vient le week-end de clôture, où se retrouvent les couples qui désormais se connaissent bien. Le samedi soir, c’est la fête autour d’un dîner suivi d'un petit "topo" du père Quinson autour de la question difficile "Qui est Dieu?"
 Le groupe Scout, c’est quatre unités principales bien connues des paroissiens : les Jeannettes, les Louveteaux, les Eclaireurs et les Guides, composées chacune d’une trentaine d’enfants et d’adolescents. C’est aussi deux unités Aînées, les Routiers et les Guides Aînées, composées de jeunes adultes de plus de 17 ans. Ils forment la Communauté des Aînés, un joyeux et bruyant mélange de garçons et filles heureux de se retrouver une fois par mois le soir pour manger, prier, rire, partager les problèmes propres à chaque Unité et se former sur des sujets divers comme cette année « choisir la vie ».
Qu’il neige ou qu’il vente, les Unités se réunissent tous les 15 jours ; une régularité qui permet une bonne application de la méthode pédagogique propre à chacune.
Ainsi, les Louveteaux jouent dans la jungle (car l'histoire de Mowgli est à la base de leur pédagogie), les Jeannettes s’en vont régulièrement sur les sentiers de la forêt (sur les traces de Jeanne d'Arc, dont la vie et surtout la spiritualité servent de modèle pédagogique, et de son amie Guillemette, laquelle donne son nom à la cheftaine), tandis que les Guides et les Eclaireurs font de la nature (parisienne...) leur terrain de jeu et de pratique des techniques du scoutisme, même par temps de pluie afin de respecter l’adage selon lequel le scout « n’est pas soluble dans l’eau. »
Puis arrive Pâques et le temps des premiers camps, d’un premier contact avec la nature encore froide et endormie, camp redouté parfois (par les parents aussi !), mais toujours riche en apprentissage, en jeux, veillées, feux et froid, et en approfondissement des connaissances, y compris de soi-même. On y part parfois avec des pieds de plomb mais à la fin du séjour, on ne veut plus se quitter ! Enfin viendra le temps des grandes vacances et des camps d’été pour toutes les Unités. D’ici là, certains Chefs auront suivi une formation théorique et pratique pour obtenir le droit de camper, formation que certains auront complétée par l’Attestation de Formation aux Premiers Secours, obtenue cette année auprès de la Croix Rouge.
Alors, entre visites de musée, jeux dans les bois de Vincennes ou de Boulogne, aux Tuileries ou aux Buttes-Chaumont, week-end en forêts ou camps et formation personnelle, quel est donc « ce grain de folie », comme disait Thérèse d’Avila, qui fait que cela marche ?
Comme tout groupe qui essaye de vivre harmonieusement, le groupe Scout est naturellement saisi par l’imprévisible de ce qui va se vivre ensemble, et cela lui permet de révéler ce que, profondément, il est. Jean Paul II, s’adressant aux jeunes, leur disait : «J’ai confiance en vous parce que là où le Christ est présent, il y a générosité, capacité de sacrifice, persévérance dans le bien, attention au prochain, dévouement concret». Notre paroisse, par son accueil fraternel et chaleureux, les accompagne en ce sens.
Le groupe Scout, c’est quatre unités principales bien connues des paroissiens : les Jeannettes, les Louveteaux, les Eclaireurs et les Guides, composées chacune d’une trentaine d’enfants et d’adolescents. C’est aussi deux unités Aînées, les Routiers et les Guides Aînées, composées de jeunes adultes de plus de 17 ans. Ils forment la Communauté des Aînés, un joyeux et bruyant mélange de garçons et filles heureux de se retrouver une fois par mois le soir pour manger, prier, rire, partager les problèmes propres à chaque Unité et se former sur des sujets divers comme cette année « choisir la vie ».
Qu’il neige ou qu’il vente, les Unités se réunissent tous les 15 jours ; une régularité qui permet une bonne application de la méthode pédagogique propre à chacune.
Ainsi, les Louveteaux jouent dans la jungle (car l'histoire de Mowgli est à la base de leur pédagogie), les Jeannettes s’en vont régulièrement sur les sentiers de la forêt (sur les traces de Jeanne d'Arc, dont la vie et surtout la spiritualité servent de modèle pédagogique, et de son amie Guillemette, laquelle donne son nom à la cheftaine), tandis que les Guides et les Eclaireurs font de la nature (parisienne...) leur terrain de jeu et de pratique des techniques du scoutisme, même par temps de pluie afin de respecter l’adage selon lequel le scout « n’est pas soluble dans l’eau. »
Puis arrive Pâques et le temps des premiers camps, d’un premier contact avec la nature encore froide et endormie, camp redouté parfois (par les parents aussi !), mais toujours riche en apprentissage, en jeux, veillées, feux et froid, et en approfondissement des connaissances, y compris de soi-même. On y part parfois avec des pieds de plomb mais à la fin du séjour, on ne veut plus se quitter ! Enfin viendra le temps des grandes vacances et des camps d’été pour toutes les Unités. D’ici là, certains Chefs auront suivi une formation théorique et pratique pour obtenir le droit de camper, formation que certains auront complétée par l’Attestation de Formation aux Premiers Secours, obtenue cette année auprès de la Croix Rouge.
Alors, entre visites de musée, jeux dans les bois de Vincennes ou de Boulogne, aux Tuileries ou aux Buttes-Chaumont, week-end en forêts ou camps et formation personnelle, quel est donc « ce grain de folie », comme disait Thérèse d’Avila, qui fait que cela marche ?
Comme tout groupe qui essaye de vivre harmonieusement, le groupe Scout est naturellement saisi par l’imprévisible de ce qui va se vivre ensemble, et cela lui permet de révéler ce que, profondément, il est. Jean Paul II, s’adressant aux jeunes, leur disait : «J’ai confiance en vous parce que là où le Christ est présent, il y a générosité, capacité de sacrifice, persévérance dans le bien, attention au prochain, dévouement concret». Notre paroisse, par son accueil fraternel et chaleureux, les accompagne en ce sens.



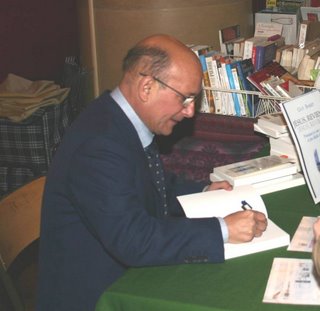
 Jean MATHIOT, L’Indien Juan Diego et Notre-Dame de Guadalupe,
éd. Téqui, 2003, 222 p., 24 euros.
Jean MATHIOT, L’Indien Juan Diego et Notre-Dame de Guadalupe,
éd. Téqui, 2003, 222 p., 24 euros.  sanctuaire lui soit construit. A sa dernière apparition, elle laisse son image « imprimée » dans le manteau de l’Indien.
Noël 1531 : l’image sainte est installée par l’évêque de Mexico dans un petit ermitage, lieu des premiers pèlerinages à Notre-Dame de Guadalupe.
1532 à 1537 : 7 à 8 millions d’Indiens demandent spontanément le baptême.
sanctuaire lui soit construit. A sa dernière apparition, elle laisse son image « imprimée » dans le manteau de l’Indien.
Noël 1531 : l’image sainte est installée par l’évêque de Mexico dans un petit ermitage, lieu des premiers pèlerinages à Notre-Dame de Guadalupe.
1532 à 1537 : 7 à 8 millions d’Indiens demandent spontanément le baptême.